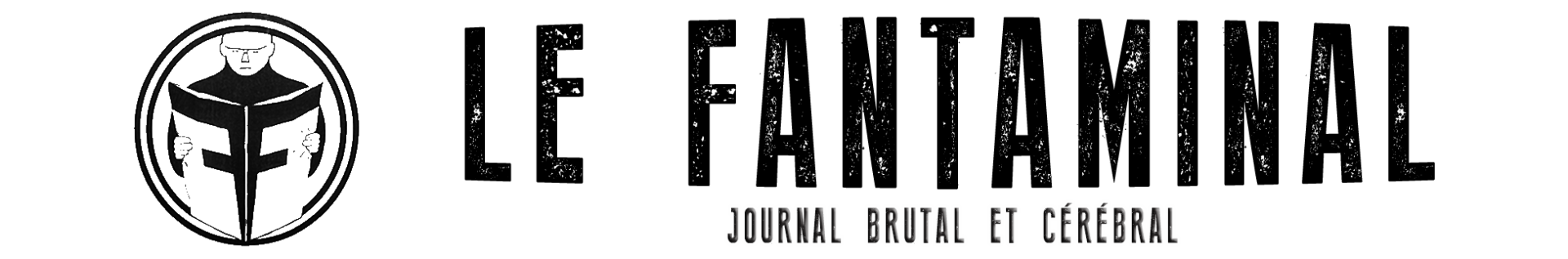Campagne et littérature, l’esprit authentique
Façonnée par l’homme, la campagne est la proie de la voracité d’un modèle civilisationnel dont l’artificialité est aussi grande que les dégâts qu’il inflige. Parole est donc donnée aux écrivains de la terre, aux poètes des saisons et de l’élémentaire.
Par Lucien Bridel
Par définition, la campagne désigne la nature domestiquée et modelée par « le travail têtu des paysans », pour le dire comme le père du jeune narrateur du roman Le Milieu de l’horizon, écrit par le Lausannois Roland Buti. L’histoire transmise par Jean à son fils Gus court depuis longtemps, du moins sous nos latitudes occidentales : née de l’agriculture, la civilisation est le fruit de la volonté de nos ancêtres de s’extraire d’un état de nature où ils étaient encore les pairs des autres animaux. Toujours est-il que la persévérance dans le labeur est réelle, à l’instar des progrès techniques issus de cette révolution anthropologique, voire anthropocentrique !
Or, on ne s’élève pas impunément. Surtout lorsque cela conduit à violer les liens qui nous unissent au vivant. Ainsi le châtiment frappe-t-il l’éleveur de l’obsédante nouvelle Les porcs de Sylvain Tesson (publiée dans le recueil Une vie à coucher dehors), comme le père de Gus qui a cru bien faire en se lançant dans l’élevage industriel de poussins. Mais, quand la canicule s’abat sur son poulailler trop grand pour être ventilé, quand les cadavres des volatiles morts de chaud sont becquetés par leurs congénères en sursis, c’est l’âme du paysan qui part en morceaux.
L’été torride dans Le Milieu de l’horizon n’est pas sans rappeler l’accablante touffeur décrite par Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947) dans Présence de la mort, ce roman apocalyptique où la Terre se rapproche inexorablement du Soleil après un « accident survenu dans le système de la gravitation ». Un dérèglement cosmique qui mène au désordre, au chacun pour soi, à la perte de repères que l’on croyait éternels. Rien ne va plus, comme dans le poulailler surchauffé où les corps cannibalisés des poussins n’ont « plus l’air de faire partie de la nature », à tel point que, du haut de ses treize ans, Gus est forcé de constater la fin du « pacte scellé il y a des millénaires ».
Le pacte d’authenticité
Parmi les textes caractérisant l’essence de ce pacte, citons la nouvelle intitulée Trois morts de Léon Tolstoï (1828-1910) où sont exposés les passages de vie à trépas d’une noble dame, d’un paysan et d’un arbre. La première meurt amère. Pétrie de convictions artificielles, trop civilisées, elle se révèle incapable d’accepter son sort sans se cabrer. Le second, fort de son rapport harmonieux avec l’univers, ne se braque pas. Il meurt serein, car son expérience de la nature et sa confrontation avec l’élémentaire l’ont éveillé à sa propre finitude, comme à celle de toute chose. Quant à l’arbre, sa mort est belle. Et c’est peut-être dans la description lumineuse de sa chute et de la trouée ouvrant ainsi sur le ciel qu’apparaît, telle une évidence, le principe sur lequel repose ce pacte millénaire dont la trahison hante Les porcs et Le Milieu de l’horizon. Ce principe, à l’aune duquel Tolstoï évalue l’éthique de ses personnages, c’est l’authenticité.
Gage d’harmonie, l’authenticité semble être ce que poursuivent les héroïnes de Deux femmes et un jardin d’Anne Guglielmetti. En fondant leur relation autour d’un jardin merveilleux, Mariette et Louise – une ancienne femme de ménage et une adolescente – redécouvrent la vie dans ce qu’elle a de simple, de délicat et de beau. L’authenticité n’est donc pas une abstraction, elle s’éprouve, se ressent, et surtout, s’apprend. Une leçon souvent douloureuse. Soit parce qu’à l’instar de la noble dame de Trois morts, on ne connaît rien sinon les faux-semblants de la civilisation, soit parce que trop jeune ou trop pressé, on ignore la volatilité des sentiments, leur façon d’aller et venir au gré des saisons.
Aline, dans le roman du même nom de Ramuz, en fait la torturante expérience. Elle qui rêve d’amour et se berce d’illusions au cœur de l’été, oublie la duplicité des hommes, confond authenticité et passion.
Pourtant, si Aline ignore l’ampleur de la cruauté de ses semblables, elle en connaît la réalité. En témoigne sa pitié pour les animaux qu’on écrase en travaillant la terre, ou que l’on dénature et réduit en esclavage, tel le montreur de bêtes qui, sur la place du village, tourmente son singe qui a « le dedans des mains comme un homme ».
Renouer avec l’authenticité et sauver ce qui peut l’être passe par le retour à l’essentiel. Ainsi écrivait Ramuz à son ami le peintre Alexandre Cingria (1879-1945) : « Je ferai des paysans, parce que c’est en eux que je trouve la nature à l’état le plus pur et qu’ils sont tout entourés de ciel, de prairies et de bois où j’aime à vivre dans mon âme. »
Bibliographie :
Le Milieu de l’horizon, Roland Buti, Zoé poche
Une vie à coucher dehors, Sylvain Tesson, folio
Présence de la mort, Charles Ferdinand Ramuz, Zoé poche
La Mort D'Ivan Ilitch. Trois Morts, Maitre Et Serviteur, Léon Tolstoï, folio classique
Deux femmes et un jardin, Anne Guglielmetti, folio
Aline, Charles Ferdinand Ramuz, Zoé poche