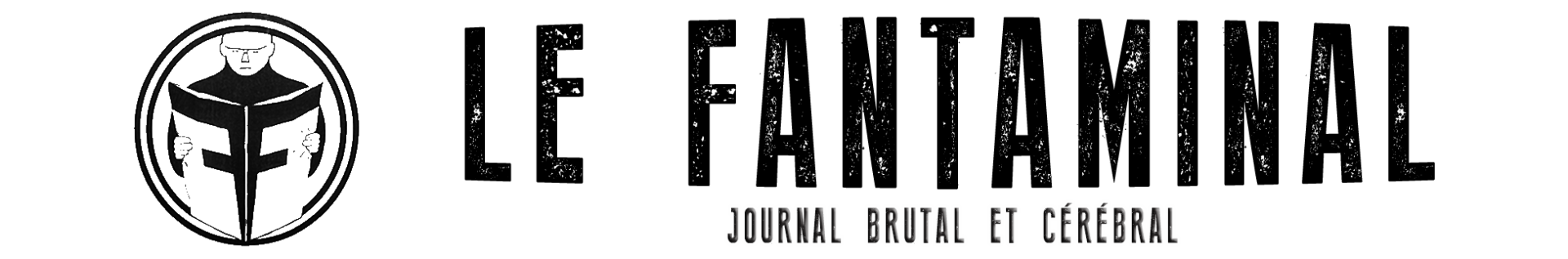La révolution romantique ou la liberté pour étendard
Par Lucien Bridel
Au début du XIXe siècle, la vague du romantisme déferle sur la France emportant l’adhésion d’une jeunesse désenchantée mais audacieuse. De cet engagement naît une conscience politique pour laquelle la liberté est l’ultime aspiration.
Ses racines, le romantisme les puise d’abord en Allemagne chez Goethe (1749-1832), Beethoven (1770-1827) et Novalis (1772-1801), puis outre-manche chez Lord Byron (1788-1824), Mary Shelley (1797- 1851) ou encore Walter Scott (1771-1832). Et pourtant, l’élément déclencheur de son émergence n’est autre que la Révolution française de 1789 ! Mettant fin à des siècles de monarchie absolue, cet événement bouleverse profondément les sociétés européennes. À travers le continent, les intellectuels y voient la promesse d’un monde enfin éclairé par la Raison. Mais la Terreur, l’instabilité des régimes qui se suivent et l’aventure napoléonienne éteignent ces espoirs portés par les Lumières.
En France, cependant, malgré la désillusion, on reste pour quelque temps fidèle à l’héritage esthétique et philosophique des Lumières, à savoir le néoclassicisme et à la primauté de la raison. En Allemagne et en Angleterre, en revanche, on se rebelle contre ce legs, ultime avatar d’une longue hégémonie culturelle française, comme le montre l’ouvrage collectif Religion et culture en Europe au 19e siècle. Les artistes trouvent de nouvelles sources d’inspiration telles que le Moyen-Âge, la spiritualité chrétienne, le folklore, le surnaturel, les voyages et le rêve. Le temps est à l’introspection, à l’exploration des émotions et des mystères de l’âme, à la célébration de la nature et, surtout, à la quête d’une liberté nouvelle où prévalent les aspirations, fussent-elles irrationnelles, de l’individu…
Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, qui incarne cette littérature à merveille, connaît un succès aussi retentissant qu’inquiétant: les tailleurs croulent sous les commandes de vêtements identiques à ceux de ses personnages alors qu’une vague de suicides au pistolet, façon Werther, frappe de nombreux jeunes hommes! Ce mimétisme incite l’Église à demander l’interdiction du roman dont la forme épistolaire, soit dit en passant, a singulièrement favorisé la mise en scène des épanchements du héros et l’avancement de son moi.
Le combat pour la liberté dans l’art
À cause de son caractère antifrançais, le romantisme n’atteint la France qu’à partir des années 1820. Là, il donne lieu à de multiples tentatives de définitions aussi positives que négatives. Cité dans 1815-1870 La Révolution inachevée de Sylvie Aprile, Louis-Simon Auger, directeur de l’Académie française en 1824, panique: « Un nouveau schisme littéraire se manifeste aujourd’hui, faut-il donc attendre que la secte du romantisme mette en danger toutes nos règles, insulte tous nos chefs-d’œuvre ? » Ce que le garant de la culture officielle voue ainsi aux gémonies, c’est la volonté d’artistes français de briser le moule académique.
Selon Lamartine (1790-1869), Victor Hugo (1802-1885), Théophile Gautier (1811-1872), Gérard de Nerval (1808-1855) et l’armée des romantiques dans son ensemble, ce corpus de contraintes esthétiques et de valeurs issu des Lumières qui imprègne les structures étatiques, les salons et l’éducation a fait son temps ! Il ne correspond pas à l’état d’esprit du moment, à ce balancement entre l’audace et cette mélancolie que l’on qualifie de « mal du siècle ». Un désenchantement qu’Alfred de Musset (1810-1857), dans La Confession d’un enfant du siècle, explique ainsi: « Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes: le peuple qui a passé par 93 et par 1814 porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n’est plus; tout ce qui sera n’est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux. » La première date renvoie à l’instauration de la Terreur et à la décapitation de Louis XVI, la seconde à la fin du premier Empire et à la restauration de la monarchie.
Toujours est-il qu’il y a, parmi les romantiques, un personnage capable de faire advenir ce qui n’est pas encore. Cet écrivain-poète qui va faire vaciller la littérature d’hier et inspirer celle de demain, c’est Victor Hugo. Alors qu’il vient de publier anonymement son roman contre la peine de mort Le Dernier jour d’un condamné, Hugo lance ouvertement les hostilités contre le classicisme académique. Nous sommes le 25 février 1830 et ce soir, sur la scène – ô combien officielle – de la Comédie-Française, se joue la Première d’Hernani, la pièce par laquelle Hugo veut imposer l’esthétique romantique. Inspiré par Shakespeare, le futur auteur de Notre-Dame de Paris et des Misérables explose les règles classiques en faisant coexister sur scène le sublime et le grotesque, le comique et le tragique, rejouant ainsi la vie dans toutes ses contradictions. Sans oublier, au passage, de dynamiter les codes de l’unité de temps et de lieu si chers aux classiques. Du sublime et du grotesque, en veux-tu, en voilà ! Dans le public, la bataille fait rage entre soutiens et adversaires du poète. On se frappe, on hurle, on s’écharpe; le triomphe de la nouvelle garde menée par Hugo n’en est que plus retentissant !
De la liberté artistique à la conscience politique
En France, le romantisme se situe d’abord à droite, du côté de la restauration monarchique. Les libéraux, héritiers loyaux des Lumières, défendent alors ardemment le classicisme et le culte de la raison. Le combat pour s’affranchir de ces codes, qui empêchent l’art d’entrer en modernité, conduit finalement les romantiques à basculer vers la gauche. Vivre d’un art qui parle de soi, de la nature et, pour citer Baudelaire, des aspects du Beau « que les artistes du passé ont dédaignés » n’est possible que dans une société débarrassée de la censure, où la liberté de la presse est garantie, bref où la liberté individuelle ne résulte pas de privilèges. Si certains feront fortune et atteindront la gloire éternelle, beaucoup d’artistes payeront leur audace au prix fort. Ni la misère, pas plus que la folie, la maladie, l’exil ou oubli ne ternissent leur contribution à cette révolution culturelle dont Hugo proclame ainsi, dans la préface d’Hernani, le ralliement au libéralisme: « Le romantisme n’est, à tout prendre que le libéralisme en littérature. Le libéralisme littéraire ne sera pas moins populaire que le libéralisme politique. La liberté dans l’art, la liberté dans la société, voilà le même but auquel doivent tendre d’un même pas tous les esprits conséquents et logiques. »
Bibliographie:
Religion et culture en Europe au 19e siècle, Jacques-Olivier Boudon, Jean-Claude Caron, Jean-Claude Yon, Armand Colin
Les Souffrances du jeune Werther, Johann Wolfgang von Goethe, Poche
1815-1870 La Révolution inachevée, Sylvie Aprile, Folio
La Confession d’un enfant du siècle, Alfred de Musset, Poche
Le Dernier jour d’un condamné, Victor Hugo, GF Flammarion
Hernani, Victor Hugo, Folio