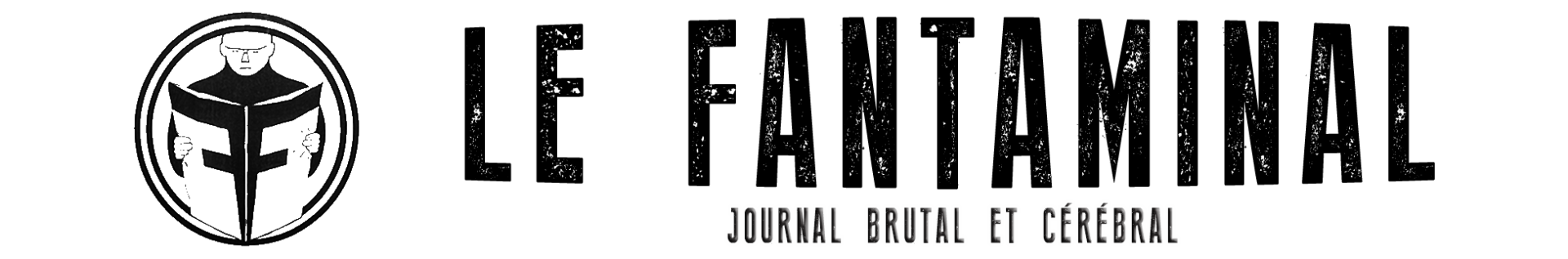Lucien Bridel
«A ce dont l’esprit se contente,
on mesure l’étendue de sa perte»
G. W. F. Hegel
NUIT SAXONNE
Notes de train: Le mal est partout
J’apprécie les voyages en train. Pourvu que l’on soit bien installé, ce véhicule est idéal pour se cloîtrer dans sa bulle, lire, observer, ou même tenter une conversation. Et si le voisin est un raseur, il suffit de lui tourner le dos pour admirer le panorama ou de commenter avec emphase la souvent banale, mais parfois extravagante laideur des sites pollués par la présence humaine: zones industrielles, cités dortoirs et grisaille de particules; champs de batailles et fosses communes, depuis toujours le mal est partout. Le pays que je parcours masque ses maux grâce aux sens du devoir et de la discipline de ses citoyens. A l’origine de ces penchants, un désir d’ordre: une pulsion morbide qui rejette tout ce qui démontre que la vie est aussi l’expression du chaos. Habitée par un peuple certain de sa singularité dans le bien comme dans le mal, cette nation peut le meilleur, mais reste coupable du pire. D’ailleurs, elle adore s’ériger en exemple et croire que ses prouesses comme ses crimes sont incomparables aux regards de l’histoire et de la morale universelle. Serais-je capable d’un tel idéalisme? De faire fi à ce point de la réalité? Ce pays où les gens sont à ce point étranges qu’il en intrigue ma conscience, c’est l’Allemagne. L’Allemagne dont j’exclus l’élection ou la damnation, me fascine pourtant par la singularité de son infamie passée.
Madame Klug: Le mur invisible
Je me rends à Berlin en passant par la Saxe, suivant un itinéraire jalonné d’arrêts et de changements de train. Dans les brasseries et les gares où je fais escale, je regarde, j’écoute et j’évite les conversations trop longues. Parfois, grisé par une rencontre, j’ose franchir le mur qui me sépare des Allemands, ce garde-fou dont pourtant je connais la nécessité. C’est Frau Klug, une institutrice d’un autre temps, d’une autre vie peut-être, qui m’a conditionné à longer scrupuleusement cet édifice dont elle se prenait pour une sentinelle des plus alertes. Madame Klug est la première personne à m’avoir raconté l’Allemagne et expliqué comment meurent les empires. J’ai rencontré madame Klug alors que je vivais à Rome avec ma famille et que nous étions sur le point de partir pour Berlin. Ma sœur et moi étions très jeunes et nos parents avaient engagé cette institutrice et traductrice à la retraite pour nous familiariser avec la langue allemande. Les leçons se déroulaient au domicile de madame Klug, un petit trois-pièces au confort oppressant. La moquette trop molle, les tapis poilus, les napperons en dentelles et les rideaux pesants qui tamisaient la lumière du jour; le sofa qui grattait, les tables et les chaises massives luisantes de verni: tout était inadapté et en contradiction avec le climat local. Rien ne pouvait rafraîchir cet endroit. Le moindre courant d’air était étouffé, tué dans l’œuf et asphyxié par la laine qui envahissait cet appartement avec l’ardeur d’un végétal. Pourtant, madame Klug détestait la chaleur. Rome l’étranglait. L’air touffu au goût de benzine, les bruits et le désordre dégoulinants sous le soleil d’Italie, tout cela l’épuisait et la cantonnait dans son petit chez-soi, cet étrange appartement à la périphérie de Rome décoré comme un chalet bavarois.
Madame Klug: Mort d’un empire
Madame Klug ne pouvait concevoir l’attachement que j’éprouvais pour cette ville dont elle n’aimait que les monuments et les œuvres d’art, vestiges d’un passé qu’elle fantasmait autant qu’elle idéalisait. L’Italie était pour elle un musée à ciel ouvert, gardé et entretenu par un personnel vivant sur place qui l’avait d’abord charmée puis déçue. Malgré ma jeunesse, je percevais les sentiments que lui inspiraient les habitants de la botte et ceux de la ville éternelle. Madame Klug leur reprochait une faiblesse morale et caractérielle qu’elle attribuait tantôt au climat et à l’organisme prétendument défaillant des Méditerranéens, tantôt aux vicissitudes de l’Histoire avec un grand H. Bref, elle ne voyait pas en eux les dignes héritiers de leurs ancêtres: ou bien ils étaient des imposteurs, ou alors, et c’était le plus probable selon ses dires, ils étaient les rejetons dégénérés d’une civilisation autrefois supérieure.
Monsieur Höhn: L’ennemi au quotidien
La nuit tombe et l’image de madame Klug s’enfuit avec le paysage derrière la vitre qui bientôt devient miroir. Je décolle mon front de la fenêtre et regarde le reflet des autres passagers. Il y a cette femme vêtue de fausses fripes savamment négligées et dont les enfants, des blondinets habillés comme des papooses, jouent à des jeux de société sur un plateau aimanté. La petite famille s’est étalée sans vergogne, mais en bon ordre, avec organisation. Plus loin, un groupe de touristes asiatiques somnole. Agrippés à leur sac à main, ils ne ronflent que d’un œil. Tout près de moi, un homme et une femme sont assis immobiles. Elle, je la distingue à peine, mais lui, j’ai pu l’observer quand il faisait jour. Le visage pointu et la peau tendue par de longues rides nerveuses il a l’œil méfiant, et sa physionomie est celle d’un oiseau. Il me rappelle M. Höhn, notre voisin de palier à Berlin, un être chétif et propret qui épiait nos faits et gestes avec l’avidité d’un volatile en quête de restes à dérober. Dès notre arrivée, Höhn nous avait pris en grippe. La présence d’enfants lui était insupportable. Nos cris, nos courses et nos pleurs stimulaient une anxiété qui le rongeait déjà profondément quand il était seul avec son épouse: une femme au goût douteux et aux formes généreuses d’infirmière à la retraite qui le surveillait comme le lait sur le feu. Pour maîtriser son angoisse, Höhn faisait de l’ordre et passait ses journées à ranger son appartement, à briquer sa voiture, mais surtout à soigner la pelouse de sa parcelle de jardin. A genoux sur le gazon, il sectionnait aux ciseaux les brins d’herbe qui avaient échappé à la tondeuse. Puis, il taillait fiévreusement son rosier sous l’emprise de cette jouissance du travail bien fait qui envahit aussi bien le maniaque que l’artiste. Enfin, il terminait son sacerdoce accroupi devant ses fleurs les plus précieuses qu’il toilettait selon une procédure immuable: d’abord, il soufflait délicatement sur les pétales pour en chasser les souillures du quotidien, puis, il les humidifiait au brumisateur. Höhn ne relevait la tête que lorsque la voix inquiète de sa femme se faisait suffisamment forte. Généralement, elle lui apportait un soda sur un plateau. Mme Höhn se donnait de la peine et moi, je ne pouvais, malgré mon mépris, m’empêcher de la plaindre.
Notes de train: Folie et passé fictif, le syndrome de la table rase
Dehors, la nuit s’affaisse sur les derniers rayons du jour qui fendent l’horizon. J’allume la lampe qui m’est réservée et tire le rideau sur l’obscurité quand, au bout du wagon, la porte s’ouvre avec fracas et projette une silhouette qui trébuche. L’ombre se relève, c’est un homme qui titube et avance en s’agrippant aux rails des porte-bagages. Il rit sous cape quand les voyageurs endormis sursautent à son passage. Vêtu avec élégance, le voyage l’a néanmoins débraillé: son veston est de travers et sa chemise sort de son pantalon. Il transpire. La sueur coule le long de ses tempes et plaque ses cheveux blancs sur son front. Il exhale, malgré les effluves d’eau de toilette, une odeur de bière et de Schnaps.
- Prochain arrêt Karl-Marx-Stadt! Annonce-t-il en se plantant devant moi, le menton haut et les bras tendus le long du corps. Son visage aigu, s’il n’était pas en cet instant tordu de fatigue et empâté par la boisson, imposerait aisément cette déférence craintive que l’on vouait autrefois aux aristocrates prussiens. Mais cet homme est bel et bien ivre. Le voilà qui répète son annonce et qui m’apostrophe méchamment comme s’il me donnait un ordre: «Saviez-vous qu’en 1953, le SED (Le Parti Socialiste Unifié d’Allemagne au pouvoir en RDA) débaptisait Chemnitz pour lui donner le nom de Karl-Marx-Stadt… le saviez-vous?» Je ne réponds pas. L’homme se redresse. Il arrange ses lunettes à monture d’écaille qui lui tombent du nez et s’essuie la figure avec un mouchoir en tissu. Mon silence l’irrite et l’embarrasse. Chancelant, il inspecte sa tenue et en réalise la négligence. Gêné, il borde sa chemise, tire sur les pans de son veston, ajuste son pardessus et finalement, s’assied en face de moi. Le siège siffle sous son poids, mais déjà, l’homme se cabre et tend son bras pour allumer la liseuse au-dessus de lui. Ce faisant, il confond les interrupteurs et éteint la lampe qui m’éclaire. J’allume les deux ampoules. Nos regards se fixent enfin. Il a des yeux sévères et secs, mais jaunis par je ne sais quel travers.
- Que voulez-vous?
- Eh bien, que vous répondiez à la question! Rétorque-t-il en prenant un air pincé. Savez-vous que la ville de Chemnitz…
- Oui, je sais.
- Et quelle leçon en tirez-vous, dites-moi? Son ton professoral contraste avec son élocution fatiguée et boursouflée par l’alcool: «Je vais vous le dire puisque vous séchez! Sachez jeune homme que le communisme, cette infâme émanation du progressisme qui nous promettait le bonheur universel pour demain, a toujours voulu supprimer le passé de ceux qu’il endoctrinait et opprimait. Pour ces gens-là, pour les communistes je veux dire… eh bien, le passé c’était le mal… C’était l’ennemi ultime dont il fallait libérer l’humanité pour tout recommencer à zéro! Lisez les paroles de l’Internationale et vous comprendrez. (L’internationale Communiste en allemand traduit du passé faisons table rase par de l’oppresseur faisons table rase)» Il se tait, reprend son souffle.
- Tenez, murmure-t-il en sortant deux bières de la poche de son pardessus, je les ai prises au wagon restaurant, mais j’ai oublié de les faire ouvrir… Je vous en offre une si vous parvenez à les décapsuler…
Je saisis les bouteilles et les ouvre avec un briquet. Nous buvons. Encouragé par l’effet revigorant d’une longue gorgée de bière fraîche, je demande: «Ne croyez-vous pas que tout le monde connaît cette envie de faire table rase?»
- Vous pensez qu’il s’agit d’un phénomène universel, répond-il immédiatement, il est vrai que nous Allemands sommes aussi experts en heures zéro que vous autres Français et cela même si nous ne sommes pas des révolutionnaires égalitaristes… vous êtes Français n’est-ce pas?
- Je ne suis pas Français, je suis Suisse francophone…
- La Suisse… dit-il en expirant comme s’il avait mal au ventre, parlons français tout de même, ajoute-t-il presque déçu, je le sais bien et ça me fera de l’exercice… Bravo pour votre allemand! C’est une langue subtile qui requiert une certaine forme d’esprit et beaucoup d’efforts pour être parlée correctement, d’ailleurs nombre d’Allemands la parlent très mal… sans parler de vos compatriotes germanophones, que vous n’aimez guère je crois… Donc je vous félicite. Mais revenons à nos moutons comme disent les Français… Avez-vous remarqué comment les pouvoirs politiques qui promettent le changement travestissent le passé et excitent nos pulsions?
- Je pense l’avoir noté à maintes reprises en effet, mais je ne crois pas avoir formulé cette idée aussi clairement que vous.
- C’est que j’ai vécu cette folie de très près jeune homme, je suis né dans Berlin en ruines… Il avale une longue gorgée bière et ses yeux jaunes ont l’air soudain beaucoup moins secs.
- A propos de folie, savez-vous comment Schopenhauer la définissait? Il fixe le goulot de sa bouteille. Vous ne savez pas? Je vais vous le dire: Schopenhauer disait de la folie qu’elle est une maladie de la mémoire provoquée par un trauma. Les fous, pensait Schopenhauer, sont obligés pour survivre de rejeter les événements insupportables du passé et de les remplacer par des fictions. Et, ce passé chimérique, s’exclame l’homme en écartant les bras et en levant des yeux écarquillés vers le plafond, les fous y croient dur comme fer! Savez-vous comment ils finissent ces malades? Par être totalement gouvernés par leurs caprices du moment, par leurs pulsions de l’instant! N’est-ce pas terrifiant? Pourtant, Schopenhauer ne considérait pas que la maladie empêche les fous de raisonner, et il avait raison! Les fous ont leur logique, l’histoire le démontre! Quelle belle intuition, n’est-ce pas? Les grands philosophes sont prophètes, c’est à cela qu’on les reconnaît…
- Je vois, mais que devinait exactement la théorie de Schopenhauer selon vous?
- Il fut un temps où nos livres d’histoire apprenaient aux enfants que les Grecs et les Romains étaient nos ancêtres et de véritables Aryens, voilà ce que comprend sa théorie! Nous, Allemands, avons longtemps été, comme les Russes d’ailleurs, experts en folie et trous de mémoire, mais, si nous, Allemands, bouchions ces trous avec de très belles fictions, les Bolchéviques se contentaient de rejeter le passé qui les dérangeait en le supprimant purement et simplement.
- Nos ancêtres les Romains! J’ai parfois l’impression que vous y croyez encore… Tenez, madame Klug, la femme qui m’a…
- Taisez-vous jeune homme! Tous les peuples peuvent devenir fous; toutes les nations peuvent tomber malades de leur histoire au point de s’inventer un passé, hurle-t-il en dressant l’index comme un pasteur en colère, mais pour nous Allemands, c’est terminé: nos folies sont de telles béances que le monde entier pourrait s’y abîmer. Ces folies en disent autant sur la nature humaine que sur nous! Examinez l’Allemagne, vous comprendrez l’Europe, et si vous comprenez l’Europe, vous comprendrez le monde!
L’homme fixe à nouveau le goulot de sa bouteille comme si ce bec de verre était à l’origine de ce qu’il vient de proférer.
- Alors rien n’a changé et comme dit la chanson, vous les Allemands, êtes au-dessus de tout!
- Ha! Comme vous y allez mon garçon! C’est scandaleux, ce n’est pas en ordre… Vous plaisantez avec de ces choses, scande-t-il en allemand la bouche tordue par d’horribles tremblements, c’est impossible! Mais vous ne me ferez pas dire que j’ai honte d’être Allemand, pas vous!
- Il suffirait que je vous raconte une anecdote pour que vous ayez honte. Vous Allemands, vous croyez tellement à part que vous vous sentez engagés par tous les actes de vos compatriotes fussent-ils imbéciles!
- L’histoire ne nous donne pas le choix jeune homme, ne l’avez-vous pas remarqué?
- Vous donnez des leçons, très bien. Mais sachez que ce culte de la responsabilité et du devoir que vous ne cessez d’afficher et de revendiquer, ne trouve pas ses origines dans vos crimes passés, mais qu’il en est la cause! Les massacres, les génocides et autres horreurs ne sont pas des accidents de l’histoire. L’histoire est tragique et si l’Allemagne s’est rendue coupable du pire, c’est à cause de cette prétendue importance qu’elle se donne depuis des lustres… Tenez! Il fût un temps où pour être un bon Allemand, il fallait au moins accepter que ces crimes soient commis au nom de l’Allemagne, pour le bien de celle-ci et pour l’ordre du monde. Aujourd’hui, se comporter en bon Allemand, c’est accepter le fardeau de ces crimes, croire en la démocratie, faire preuve de tolérance et se repentir sincèrement des horreurs commises… Repentir que d’ailleurs, vous n’hésitez pas à exhiber pour montrer qu’en matière de contrition et de pénitence, vous êtes les meilleurs.
- A vous entendre, nous portons le mal dans nos gênes. Vous n’êtes qu’un sale gamin, siffle-t-il dégoûté.
- C’est en nous, en chacun de nous. Mais vous, vous croyez devoir mettre de l’ordre dans le chaos et à ce petit jeu, vous êtes mauvais! Vous savez, il n’y a pas si longtemps, j’ai pris ce même train avec ma mère et ma sœur. C’était peu après la chute du mur, quand l’Allemagne de l’Est était aussi grise que la Pologne. Pourtant, l’époque était à l’optimisme. Rappelez-vous: tous ceux qui avaient cru aux lendemains qui chantent rêvaient d’obtenir tout immédiatement! Ils croyaient aux slogans qui disaient que le présent était en train de rattraper l’avenir!
- C’est vrai, mais venez en aux faits…
- J’y viens! J’étais donc dans ce train avec ma mère et ma sœur. Le voyage était long, l’air humide et froid, ma sœur était malade et le train grinçait. C’était la première fois que nous faisions ce trajet et c’était également la première fois que je pouvais me faire une idée de ce qu’avait été l’autre côté du rideau de fer.
- C’est cela, en regardant par la fenêtre d’un train… Mais qu’est-ce que vous pouvez déblatérer comme idioties, jeune homme!
- Exactement, par la fenêtre d’un train! Vous n’imaginez pas tout ce que l’on peut comprendre d’un pays en le regardant défiler derrière une vitre. Surtout quand cette fenêtre encadre une scène aussi remarquable que celle à laquelle nous avons assisté une fois entrés en gare de Magdeburg.
L’homme s’enfonce dans son siège, il se résigne à m’écouter. Je lui raconte le quai grouillant de monde qui hurle et frappe les wagons. Ils n'étaient qu'une centaine, mais j'en voyais des milliers. Tous pareils selon leur discipline obscène, tous ivres et en fureur. Encerclés par des policiers casqués armés de matraques et de boucliers, ils montaient dans notre train comme s’ils le prenaient d’assaut. La bière et les coups pleuvaient. Les passagers témoins comme nous de ce déferlement se recroquevillaient sur eux-mêmes. C’était la horde sauvage qui nous assaillait, une vague de crânes rasés aux idées brunes et dont les bras tatoués de soleils noirs et de runes s’élevaient vers le ciel pour saluer leur idole. Roués de coups de matraques, ils ripostaient et lançaient sur les forces de l’ordre tout ce qui leur tombait sous la main, tout qu’ils pouvaient arracher. Puis, soudain, il y eut comme un flottement et un drôle de silence traversa cette masse qui démembrait notre wagon de l’intérieur. Je compris en voyant entrer, à l’avant et à l’arrière du wagon, des policiers accompagnés de chiens auxquels on avait retirés leur muselière. La violence qui paraissait indomptable un instant plus tôt, se retira d’un coup pour se terrer au fond de ceux qui l’avaient exhibée. Bientôt, nous n’entendions plus que les grognements et les aboiements des molosses qui parcouraient la voiture en montrant les crocs. Les brutes s’assirent où elles purent, muettes et humiliées, pétrifiées par la peur archaïque d’être mordu.
Notes de train: Tant qu’il y aura la honte et les chiens
Le train ralentit et l’homme lève le rideau sur les lumières de la ville qui gagnent sur la nuit. Nous sommes loin de Chemnitz. Les cadavres de nos bouteilles roulent sur la moquette et s’entrechoquent. L’homme me regarde et dit en allemand: «Vous savez jeune homme, j’apprécie les voyages en train. Pourvu que l’on soit bien installé, ce véhicule est idéal pour se cloîtrer dans sa bulle, lire, observer, ou même tenter une conversation. Et si le voisin est un raseur, il suffit de se déplacer, quelques bières en poche, pour chercher parmi les voyageurs celui ou celle qui sera capable de nous tenir en haleine, de nous faire parler ou, mieux encore, de nous apprendre quelque chose… Ce fut un plaisir mon garçon, mais nous voilà bientôt à Berlin. Je dois regagner ma place et mes bagages.» Il se lève pesamment et arrange ses vêtements. Nous nous serrons la main. Il dit: «Vous avez raison, ces fanatiques sont une honte, mais j’ai bon espoir, car tant qu’il y aura des gens pour s’en rendre compte, il y aura des chiens pour les mordre.»
Lausanne, décembre 2019