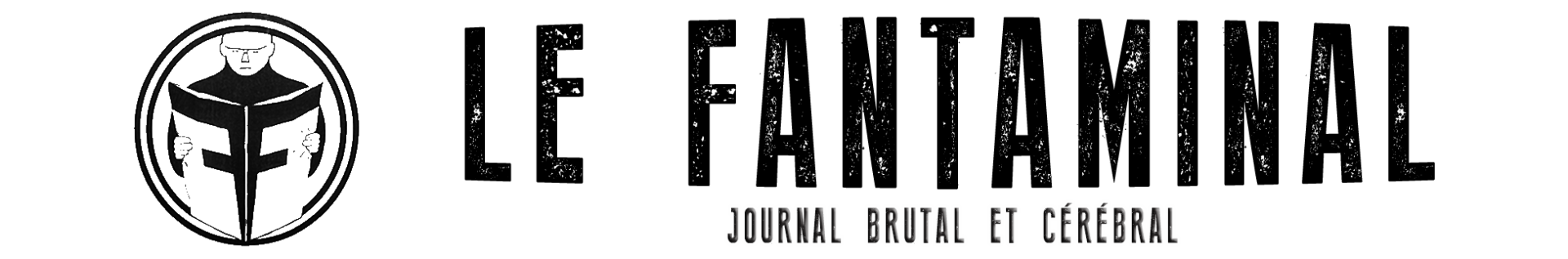Lucien Bridel
MONSIEUR ET MADAME SCHMITT
«Je ne puis croire qu’il faille tout asservir
au but que l’on poursuit»
A. Camus
Frau Schmitt
Madame Schmitt passait chez nous deux fois par semaine vendre ses poires, ses patates, ses carottes et ses fleurs. Du haut de mes dix ans, j’appréhendais ces visites. J’étais gêné par l’allure misérable de cette femme édentée qui vociférait un allemand aussi laid qu’incompréhensible. L’image mentale que ma mémoire me restitue de madame Schmitt ressemble à celle de cette sorcière, rencontrée un soir d’enfance dans un recueil de contes aux gravures pathétiques: je vois un long nez, des pommettes saillantes, une bouche fine comme une cicatrice et des yeux gris dont l’agitation trahit l’avidité et l’angoisse de la pauvreté. Si je ne sais quel crédit donner à cette vision, je me souviens très bien en revanche, que depuis la fenêtre de ma chambre, même au cœur de l’obscur hiver berlinois, je reconnaissais la silhouette de madame Schmitt entre mille. Elle tanguait de gauche à droite, parce qu’elle marchait sans plier les genoux, et elle tirait un chariot de courses rempli jusqu’à la gueule.
Allemand brisé
Madame Schmitt avait toujours un foulard sur la tête et elle était vêtue, par temps froid, de plusieurs couches de vêtements élimés, alors qu’en été, elle arborait un chemisier jaune éteint qui laissait apparaître ses bras bronzés et durcis par le travail des champs. Quelle que soit la saison, elle portait des mitaines qu’elle n’enlevait jamais, même lorsque ma mère lui offrait le petit-déjeuner qu’elle avalait tout rond faute de dents. Lorsque madame Schmitt nous regardait ma sœur et moi, c’était à la manière de ces gens pour qui les enfants sont plus proches des animaux que de n’importe quel spécimen adulte de l’espèce humaine. Malgré mon aversion pour sa personne et l’appréhension que me causaient ses visites, madame Schmitt m’intéressait. Ses histoires étaient terribles. Nous devions nous accrocher pour les comprendre et en dépit de son accent et de l’étrange patois qui brisait son allemand, nous étions suspendus à ce que nous saisissions comme des récits de fuite qui sentaient le crottin, la mort et la faim. Elle venait de Silésie, mais vivait désormais en rase campagne au sud de Berlin, là où la plaine est plate comme une assiette. Le mur venait de tomber, elle avait faim, la réunification allemande n’était pas une sinécure.
Berlin 1990
Nous, nous étions là parce que mon père couvrait cet événement historique pour un journal suisse-romand. Nous sommes restés un peu plus de trois ans à Berlin. A l’époque, cette ville n’avait rien en commun avec ce qu’elle est devenue. Son passé n’était pas vitrifié dans des musées trop beaux ou commémoré par des monuments trop épurés, mais il surgissait du sol entre les mauvaises herbes et le béton défoncé, et ses vestiges couverts de graffitis, de tags ou de peintures, explosaient la grisaille. Lorsqu’il n’était pas abandonné aux pulsions des vandales, le passé se mêlait au présent donnant à la ville ce supplément d’âme qui aujourd’hui lui fait défaut. Quand nous nous promenions dans les quartiers du centre-ville, il y avait des punks, des vrais, là où maintenant déambulent des hipsters et des étudiants venus de toute l’Europe. Des Trabants roulaient à tombeau ouvert, alors que maintenant, ce sont des voitures de collection. On pouvait, dans une même rue, voir un immeuble décharné, en côtoyer un autre flambant neuf, symbole rassurant d’un présent aux lignes pures tendues vers un avenir prospère. Il y avait des terrains vagues là où s’érigent désormais comme autant de totems les gratte-ciels de la finance et de l’industrie triomphantes. Sous les chênes et les tilleuls du quartier résidentiel où nous logions, nos pas frappaient des pavés centenaires encore marqués par les chenilles des blindés soviétiques qui avaient déferlé dans la ville pour venir à bout de la peste brune. Un gamin comme moi pouvait explorer avec sa bande des squares à l’abandon, y trouver des douilles et découvrir, derrière des buissons d’épineux, des pans de mur criblés d’impacts. En collant mon œil à ces failles, je devinais la violence avec laquelle se fait l’Histoire et, déjà, je comprenais que cette violence n’est en rien accidentelle, qu’elle n’a rien d’un épiphénomène dramatique embusqué sur la route du progrès, mais qu’elle existe parce que l’Histoire est tragique.
Œil de Schnaps
En bons journalistes, mes parents étaient de nature curieuse. Ils avaient le goût de l’aventure et savaient nous stimuler ma sœur et moi. Ma mère et mon père faisaient grand cas des questions que nous pouvions nous poser sur l’étrange pays dans lequel nous vivions. Pour eux les gens étaient des mines d’informations et ils avaient l’esprit d’ouverture de ceux qui s’interdisent de porter tout jugement hâtif. C’est lors de la visite que nous rendîmes à madame Schmitt dans sa ferme que je vis, pour la première fois, mes parents être gênés par quelqu’un. Je me souviens des regards inquiets, presque réprobateurs, que m’adressait mon père alors que j’écoutais sans trop comprendre les histoires d’Ernst Schmitt, l’époux de madame. Ernst Schmitt était un homme trapu au teint halé et aux cheveux gris et drus comme de la paille. Il avait de grosses mains sales et il lui manquait deux doigts à la gauche. Son œil vitreux, humide et délavé trahissait un penchant pour l’alcool, toutefois sa personne ne dégageait rien de pathétique. Il était fier de nous montrer la vaste étendue de terre qu’il possédait. Possession récente qui devait sortir les Schmitt de leur indigence et leur permettre d’entrer d’un bon pied dans la nouvelle ère qu’annonçait l’effondrement soviétique. Il faisait beau, la chaleur troublait la ligne d’horizon déjà enfumée par les cheminées des usines qui s’étalaient loin, au-delà des champs, à perte de vue. Perdue au milieu de cette étendue, la ferme des Schmitt était un conglomérat de bâtiments robustes cerné de vergers et de potagers. Pendant que ma sœur coursait les poules, les chiens et les chats, ma mère prenait des notes en écoutant encore et encore l’exode de madame Schmitt, tandis que mon père et monsieur, attablés sous un parasol géant, descendaient schnaps sur schnaps.
Surhomme
Cul-sec après cul-sec, Ernst Schmitt lâche la bride. Il parle fort, regrette la RDA, déjà. La plupart ont attendu quelques années avant d’éprouver l’ostalgie. Pour lui, les temps sont durs et plus incertains que jamais. Il affirme que contrairement à tous les autres, il n’est pas dupe. Ernst Schmitt pense que pour s’en sortir, il faut suivre une orientation claire et ne pas se disperser tout azimut. Maintenant qu’il est son propre chef, il faut qu’il réfléchisse. Heureusement, il a de l’expérience. Des chefs, Ernst Schmitt en a eu plein. Il boit. Bizarrement, ses pupilles rétrécissent et son œil bleu devient gris. Il me surprend en train d’observer sa main mutilée, il la regarde à son tour, puis l’avance vers moi, jusque sous mon nez. Elle est énorme et boursoufflée, lardée de cicatrices jaunes et roses qui s’enroulent, comme des lianes autour d’un tronc, le long de son avant-bras. Je crois voir un monstre. Personne ne dit mot, Ernst Schmitt me fixe et boit un coup. Mon père brise le silence: d’où viennent ces blessures, comment a-t-il perdu ces doigts? Schmitt ne lui répond pas, il dit, en me regardant encore, que si le gamin veut savoir, c’est au gamin de demander. J’ai l’impression qu’il menace mon père, qu’il veut l’intimider. Je dis: comment avez-vous fait? Ernst Schmitt rigole, il n’a rien fait, c’est Ivan, c’est ce sacré Ivan, tonnerre! Il me demande si je connais Ivan, il s’esclaffe. Je regarde mon père, je l’interroge du regard et mon père me glisse enfin: Ivan, c’est le Russe. Ce monsieur est en train de nous parler de la guerre, fiston… « C’était le bon temps! J’étais sergent dans la Wehrmacht. J’ai fait la Russie, la Grèce et l’Italie aussi. J’ai vu la steppe, la mer, le soleil, les combats et les Folies Bergères. Paris, c’était quelque chose pour nous, un gros bordel. On était des dieux, les maîtres de la vie et de la mort. C’était le bon temps! J’ai traversé l’Europe avec deux Lüger glissés dans mon ceinturon, pendant longtemps, je n’ai eu peur de rien. Dieu était avec nous, c’est ce qu’on pensait. J’avais trouvé des bottes d’officier. Je n’ai jamais eu mal aux pieds de toute la guerre. Beaucoup souffraient, moi pas. J’ai eu la croix de fer. J’étais jeune et fort. A la fin, on a tout perdu, mais c’étaient de belles années, ça oui. » Avait-il des photos? Je voulais voir des photos. Je voulais voir sa tête de l’époque, voir s’il avait l’allure d’un soudard ou celle du guerrier aryen discipliné et fanatique, certain que son apparence aurait pu m’indiquer qui il était vraiment. Mais des photos, Ernst Schmitt n’en avait plus. A la défaite, il avait cru prudent d’enfouir le passé. Il avait enterré portraits et souvenirs de guerre, tiré un trait sur sa jeunesse et compris que s’il voulait survivre, il lui fallait se convertir au socialisme et devenir un homme nouveau.
Homme nouveau
C’est ainsi qu’à partir des années cinquante, Ernst Schmitt et sa femme avaient, comme des milliers d’autres, été mis à contribution pour faire advenir la dictature du prolétariat et surtout, l’homme socialiste. On trouve, dans un lexique paru en 1980 (G. Butzmann, J. Gottschlag, G. Gurst, (dir.): Jugendlexicon a-z, 13e édition, Leipzig, 1986, p. 616.) et destiné à la jeunesse est-allemande, l’inventaire des qualités que devait posséder cet homme nouveau d’après la définition qu’en avait fait le parti au lendemain de la guerre: « La personnalité socialiste se caractérise par une fidélité aux idéaux du communisme, une attitude socialiste face au travail, l’amour de la patrie socialiste et l’engagement à la renforcer et à la défendre. Son caractère est marqué par la solidarité, la conscience de la responsabilité, la sincérité, et d’autres qualités pleines de valeur. Les personnalités socialistes se développent dans le travail, le collectif, dans l’appropriation des trésors de la culture et surtout dans une organisation raisonnable des loisirs ainsi que dans l’assimilation de la vision du monde marxiste-léniniste. » C’est ce catéchisme prométhéen qu’avaient appris les Schmitt et pour l’assimiler, ils avaient, pour la deuxième fois de leur existence, fait table rase de leur individualité. Après le Reich pour mille ans et les fictions raciales du nazisme, ils avaient dû intégrer l’utopie socialiste des lendemains qui chantent. Pour la deuxième fois, ils s’étaient soumis à un Etat qui exigeait de ses citoyens qu’ils se réalisent non pas comme individus, mais en en tant que membres d’une communauté dans laquelle il fallait entrer sans conditions.
Innocent
Depuis cette journée à la ferme, j’ai compris que les seuls moments où Ernst Schmitt s’était senti libre, c’était pendant cette période qu’il avait passée en uniforme de la Wehrmacht. Non seulement il avait eu le droit de briser les interdits les plus puissants, mais il avait pu s’exalter en vivant les émotions et les passions les plus extrêmes. Cependant, le plus troublant, c’est qu’Ernst Schmitt osait nous raconter ces années de conquêtes et de lutte, l’œil brillant et la voix tremblante de plaisir. Même si mon père n’a jamais cessé de me dire que ce type avait une conscience et qu’il était la victime de choses qui nous dépassent complètement, j’ai toujours pensé qu’Ernst Schmitt était une brute indépendamment des contingences extraordinaires qui avaient jalonné son existence. Ernst Schmitt ne se sentait coupable de rien du tout. Bien entendu, le régime nazi l’avait déresponsabilisé dès son plus jeune âge. On lui avait fait croire que sa conscience appartenait au Führer et qu’il était un surhomme protégé par la providence. En plus, après la défaite, la RDA, autre incarnation d’une pensée politique collectiviste, n’avait rien fait pour qu’un type comme lui se regarde dans la glace. L’Allemagne de l’Est ne pouvait se permettre, sans risquer de contredire les concepts qui la fondaient, de développer une réflexion sur la responsabilité individuelle des Allemands. Au regard d’une telle société, Ernst Schmitt n’existait pas. Il n’était qu’un membre de la masse allemande manipulée par le fascisme et dont la rédemption avait consisté à troquer le racisme et le nationalisme du Troisième Reich pour l’idéal d’une société sans classe et internationaliste de la RDA. De toute façon, il n’avait jamais été question pour ce régime de s’attarder sur le passé. Dès 1948 et le premier plan biennal, on avait exigé des écrivains et autres ingénieurs de l’âme un travail de représentation de la société nouvelle. Les décideurs ne voulaient pas d’un retour critique et littéraire sur un passé traumatisant et culpabilisant. Quand la justice socialiste condamnait, exécutait et purgeait la RDA d’anciens nazis débusqués de leurs planques, c’était plus par souci de propagande et pour être en phase avec la pulsion de table rase d’une plèbe vaincue, affamée et violée, que par idéal antifasciste.
Trou noir
En fin de journée, peu avant notre départ, Ernst Schmitt est tombé de sa chaise. Ses fils, deux types d’une trentaine d’années, l’ont soulevé et porté à l’intérieur de la ferme, dans la salle de séjour. Là, des diplômes en socialisme suspendus aux murs et des bibelots qui commémoraient, en rang sur les étagères, les grandes dates du communisme et ses génies, témoignaient de la conversion et donc des facultés d’adaptation d’Ernst Schmitt. Je ne me souviens pas quels mérites célébraient ces brevets couverts de tampons, à part qu’il y en avait pour toute la famille. Une fois ses moyens retrouvés, Ernst Schmitt nous les a expliqués. Bien qu’il fut le plus ostalgique des Schmitt, il était le seul à vouloir tout jeter, comme jadis, à la fin de la guerre. Il maudissait les siens parce qu’ils se réjouissaient de la chute du mur et qu’ils voulaient tout de même conserver ces diplômes et ces bibelots. Pour Ernst Schmitt, ces choses étaient désormais inutiles et même compromettantes. C’était sa logique: le passé n’existait que pour être oublié. D’ailleurs, si les souvenirs de mon père sont exacts, il exprimait cette idée avec un lyrisme des plus germaniques et quelques analogies bien senties. Ainsi, à l’instar de la roue solaire des nazis, l’étoile rouge n’était plus qu’un trou noir qui jamais ne resurgirait de l’abîme. Il fallait donc tirer un trait et s’adapter, ça valait mieux pour tout le monde.
Lausanne, décembre 2019