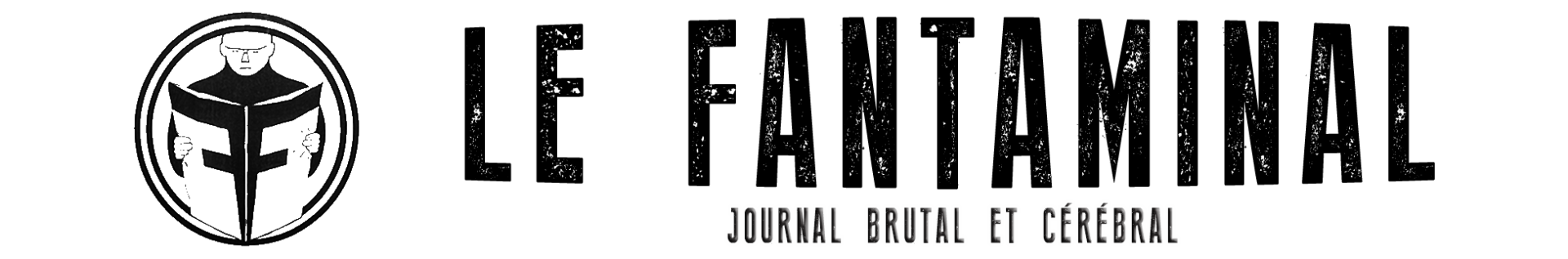Lucien Bridel
«Les hommes ne savent être ni entièrement bons,
ni entièrement mauvais»
Nicolas Machiavel
LA SUITE DU GÉNÉRAL
Il y a vingt ans, j’ai fait un voyage aux Etats-Unis. Un voyage littéraire comme on a le privilège d’en faire lorsqu’on est l’enfant de parents qui savent, ou sentent, que la culture est nécessaire pour s’enraciner dans la vie. Nous sillonnions les Etats du Sud sur les traces de Faulkner, Capote, Gaines, Mitchell et d’autres encore. Un soir nous fîmes halte dans une bourgade au bord du Mississipi, le temps de passer deux nuits chez l’habitant. La maison, une demeure de style colonial, perchée sur une colline luxuriante, dominait la ville et les environs. La chambre qu’on me prépara alors est la plus singulière où j’aie jamais dormi. Elle avait les murs tapissés d’un épais tissu rouge parcouru d’arabesques noires, où étaient accrochées des gravures et des photographies du XIXe siècle. Ces images montraient des hommes à cheval; des scènes de la guerre de Sécession, des guerres indiennes et de la construction du rail; des bateaux à aube naviguant sur le Mississipi, ainsi que des parties de chasse dans les Appalaches. Contre le mur se trouvait aussi un râtelier vertical où étaient entreposées trois armes de collection en parfait état de marche dixit le maître des lieux. Il y avait là une carabine Springfield 1861, une de 1873 ainsi qu’une Winchester dont j’ai oublié l’année. Le lit, au fond de la chambre, était couronné d’un baldaquin dont le drapé, aussi rouge que la tapisserie, coulait comme une traînée de sang sur le parquet sombre couvert de peaux de bêtes. Deux bibliothèques entouraient l’unique fenêtre, à guillotine, qui faisait face à la porte. Parmi les livres étaient disposés des objets de valeur sentimentale et historique comme l’étaient sans doute ces deux Colts Dragoon à la crosse nacrée et terriblement luisante. Une petite table en bois précieux donnait sur la fenêtre. Une bible y était posée, ouverte sur le Livre de Job. Mon hôte s’en empara et lut: «Nul n’est son maître ici-bas sur la terre. Il fut créé pour ne rien redouter» puis, tout en rangeant la bible dans la bibliothèque, il me souhaita la bienvenue «dans la suite du Général»...
Le soir, je rejoignis ma chambre sans penser à cette appellation, d’autant que je venais de vivre une drôle de mésaventure en revenant de l’épicerie. Sur la route, au bas de la colline, une voiture s’était arrêtée à ma hauteur et deux individus en étaient sortis. C’étaient des citadins à la dégaine d’employés de bureau. Je compris rapidement pour qui et quoi ils me prenaient, alors que l’un d’eux, ivre, agitait une liasse de dollars sous mon nez. L’autre, apparemment sobre, se contentait de me fixer d’un regard inexpressif, jusqu’à ce qu’il se mette à me parler de ses déboires conjugaux pour me convaincre d’accepter de les suivre comme si j’étais en train de marchander mes services. Ces types prenaient leur désir pour la réalité, ils étaient incapables d’entendre raison. A défaut de revolver à crosse nacrée, je sortis une bouteille de bière de mon sac et l’empoignai par le goulot, prêt à me battre. Les deux types remontèrent dans leur voiture qui démarra en trombe, quant à moi, afin d’éviter d’autres rencontres de ce genre, je décidai d’escalader la butte qui bordait la route. C’était un talus couvert de hautes herbes jouxtant une forêt semi-tropicale. Je ne tardai pas à distinguer plusieurs silhouettes qui montaient ou descendaient ce promontoire lorsque des voitures s’arrêtaient sur la route. Cette triste scène au milieu d’une nature foisonnante, enracina en moi la conviction que le peuple américain ne sera jamais chez lui sur la terre qu’il considère comme sienne. Ce n’est pas tant le fait colonial qui m’imposa cette évidence, mais la flagrante inadéquation de la majorité des Américains avec le décor naturel qui les entoure. Pataud et laid, le peuple américain est un importun sous le ciel immense et courbe, comme l’étaient ces prostitués à l’orée de cette jungle exubérante. Ces nécessiteux, incapables de tenir sur leurs jambes, parce que trop gras ou trop défoncés, trébuchaient et roulaient en bas le talus pour atterrir lourdement sur la route où patrouillait leur clientèle. A croire que l’Américain n’est fait que pour rouler... Voilà donc le Deep South me répétai-je à moi-même jusqu’à ce que j’arrive à la maison d’hôte. Là, je filai me doucher et allai sur la véranda boire les bières que je venais d’acheter et fumer un grand nombre de cigarettes. Une fois calmé, je rejoignis ma chambre. Prêt à me coucher, j’ouvris la sanglante voilure du baldaquin et escaladai le matelas.
C’est là, juste en face de moi, que je vis accroché au mur au-dessus de la tête de lit, le portrait de Robert Lee, le général en chef des armées des Etats confédérés. Autrement dit, le chef de l’état-major des Etats esclavagistes, vaincus par l’Union à l’issue de la guerre de Sécession en 1865. Lee me fixait du regard dominateur et satisfait des hommes pénétrés par le sentiment de leur invulnérabilité. Je me glissai sous les couvertures avec l’impression de me trouver dans l’antre de l’ennemi. Couché sur ce lit géant, haut comme une table ou un autel, j’eu un instant l’impression de servir de repas au général. Malgré la fatigue, je mis longtemps à trouver le sommeil, intrigué par la dimension cannibale de la puissance que je venais d’éprouver. Les portraits, les statues et autres représentations des hommes de pouvoir sont très instructifs. A leur contact, on apprend à reconnaître les traits et les intentions assassines du despote, ce tueur toujours prompt à envoyer les autres à la mort. C’est pourquoi il ne faut pas déboulonner tous les monuments qui les personnifient, mais en conserver une partie et voir en ceux-ci un rappel du passé qui nous force à ne pas oublier, à ne pas céder à la pulsion de la table rase. Le démontage de statues, le changement de noms de rue ou de place est une méthode de despote qui conduit fatalement à l’autodafé. Que l’on pense à Leningrad, Stalingrad et à toutes les Adolf Hitler Strasse...
Ce matin-là de notre voyage américain, je fus, très tôt, réveillé par les oiseaux. Je me levai pour aller regarder par la fenêtre. Je l’avais laissée ouverte sans baisser la moustiquaire. Un scarabée noir arpentait la petite table, ses pattes crissaient si fort sur le bois que je me demandai s’il n’en rayait pas le plateau. L’air du dehors était humide et frais. En contrebas, entre la végétation, je distinguai la route qui menait à la bourgade et les premières maisons. Je vis l’épicerie où je m’étais rendu et le Mississipi, encore gris, me parut aussi immobile qu’un instant. Je retournai au lit. Le général était là dans son uniforme d’apparat, chevaleresque et prétentieux; il y avait de la suffisance, presque de la moquerie dans ses yeux.
Je me réjouis qu’il ait été battu par des hommes tels que Grant ou Sherman, ces deux généraux nordistes, que certaines photographies d’époque montrent sales et hirsutes, peut-être même ivres. Brutaux sans doute, mais moins hypocrites, ce sont eux les vainqueurs de la guerre de Sécession, cette guerre menée au nom d’un progrès qui, s’il a imposé l’abolition de l’esclavage, a exigé, une fois celle-ci acquise, l’écrasement des dernières nations amérindiennes encore hostiles aux Etats-Unis. Tout cela pour un avenir meilleur, pour que les Etats-Unis entrent de plain-pied dans la modernité et défient puis dépassent l’ancien monde, celui des grandes puissances européennes. Aujourd’hui, ceux qui se revendiquent de l’avenir et qui jugent les hommes du passé à l’aune du présent, commettent la même erreur que tous les progressistes les ayant précédés: ils oublient que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Car celui qui veut faire l’ange fait la bête.
Lausanne, avril 2020